Jean Paul Gaultier par Duran Lantink, premier défilé du designer pour la maison. Le show n’est pas encore terminé que la toile s’enflamme déjà. Très vite, les commentaires s’écrivent par centaines.Visiblement, ça n’a pas plu à beaucoup. Personnellement, j’ai trouvé ça beau, pas tout, mais suffisamment pour saluer son talent. Sous l’effet du flux, des opinions qui s’accumulent et des algorithmes, à tort ou à raison, un doute s’installe en moi. Mon avis est-il juste ? Par conviction ou par esprit de contradiction, je suis déterminé à ne pas participer à cette vague d’influence négative. Cette unanimité numérique destructrice m’a frappé, traversant toutes les typologies de commentateurs : journalistes, influenceurs, amateurs de mode. C’est comme si, en ligne, il ne pouvait plus y avoir de nuance. Tout doit être tranché, immédiat, validé ou rejeté.
De la presse imprimée à la démocratie du regard
Des années 1950 à l’avènement de l’an 2000, la mode passait par un seul canal : la presse mode imprimée. Une poignée de journalistes,rattachés à des rédactions, détenaient le pouvoir du récit mode. Leur plume dictait le goût, influençait les clientes, faisait ou défaisait une saison. C’était un petit monde fermé, élitiste et bourgeois,où la mode s’adressait à celles et ceux qui pouvaient se l’offrir.
La critique faisait office de passeur : elle décrivait ce que peu avaient vu, traduisait l’inaccessible, et avait un impact à la fois esthétique et commercial. Son autorité tenait à la rareté de l’accès, à l’exclusivité du regard. À ce stade, la parole était libre. Aujourd’hui, la presse ne détient plus le monopole du regard. Le privilège de voir avant les autres a peu à peu disparu avec l’apparition d’un flux continu.
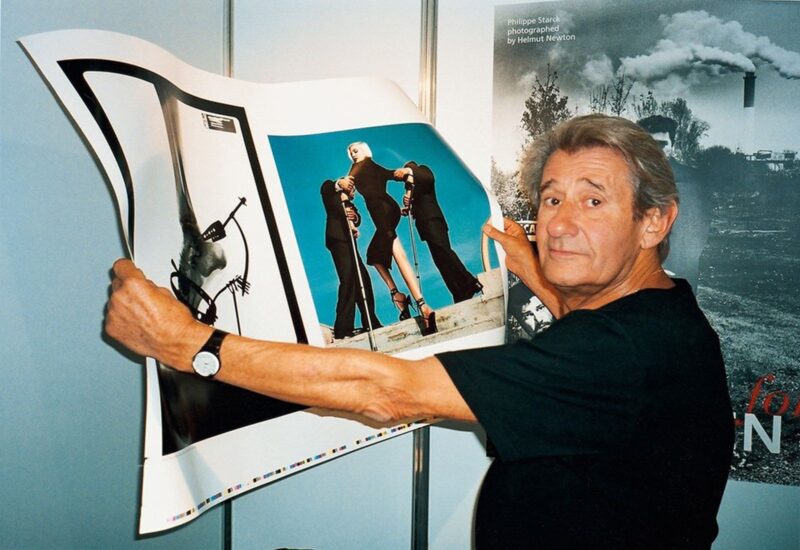
Aujourd’hui, tout le monde voit et commente en temps réel. Le regard s’est démultiplié à travers une vague d’opinions, de vidéos, de stories, de posts, d’émotions brutes. Chacun dépose son avis, souvent sincère, parfois violent. Et dans cette profusion, la nuance se perd. Jamais la mode n’aura été autant commentée, jugée, disséquée, parfois jusqu’à l’épuisement. L’impact, lui, est démultiplié : émotionnel, psychologique, économique. De quelques plumes à des milliers de voix, les points de vue s’empilent, et forment une vague capable de submerger, de glorifier ou d’anéantir.
La fin de l’indépendance du papier
Autrefois, les magazines vivaient de leurs ventes, et leur indépendance tenait à leur lectorat. Avec l’arrivée du digital, une bascule s’est opérée et c’est toute l’industrie de la presse mode qui en a fait les frais.
Les ventes se sont effondrées, saison après saison, jusqu’à devenir marginales. Le business model, lui, s’est effrité, forçant les rédactions à chercher d’autres sources de revenus. Aujourd’hui, elles vivent presque exclusivement de leurs annonceurs. Les médias deviennent les partenaires commerciaux des marques, qui dictent les règles du bout des lèvres. Ce glissement s’explique aussi par un changement de rapport de force. Les marques ne dépendent plus des magazines pour atteindre leur clientèle. Les réseaux sociaux et internet ont renversé la hiérarchie : Les maisons communiquent désormais en direct avec leurs communautés, chaque jour, en ligne.
Alors que l’indépendance n’est plus qu’un décor de papier glacé, plus les pages de publicité s’empilent, plus la liberté de dire les choses, surtout lorsqu’elles dérangent, s’amincit. Dans ce cadre, la critique frontale se raréfie et les “mauvais papiers” deviennent l’exception. La poker face est devenue structurelle, une mise en scène d’autonomie masquant la dépendance économique. Ce n’est pas une question de courage individuel, mais de système. Et c’est dans cet espace laissé vacant qu’une nouvelle génération a émergé. Non pas pour occuper une place, mais pour la recréer.
Une nouvelle génération de regards : authentiques par nature, performatifs par nécessité
Depuis quelques saisons, une nouvelle scène critique s’impose. Des voix qui parlent face caméra, des regards directs, passionnés, sans filtre. Elles ne représentent plus un magazine, mais une vision personnelle. Elles ne disent pas ce qu’il faut penser, mais expliquent ce qu’elles ont ressenti.
Ce déplacement change tout. La critique devient expérience. La parole devient présence. Le commentaire ne cherche plus à construire un récit collectif, mais à partager un ressenti personnel.

C’est à la fois intime et performatif : pour être entendu, il faut se montrer. L’algorithme impose sa règle : pour exister, il faut performer. Les nouvelles voix de la critique sont authentiques par nature, performatives par nécessité. Elles parlent avec sincérité, mais sous contrainte. Le ressenti devient une mise en scène. Et la mise en scène, une condition d’écoute. Ces commentateurs et commentatrices parlent comme la vraie critique d’autrefois : libres, frontaux, sincères. Ils disent ce qu’ils pensent, sans calcul, sans stratégie, parfois sans moyens. Mais cette liberté n’est pas acquise : elle repose sur un équilibre fragile.
La fragilité du système
Ces nouvelles voix s’expriment souvent sans contrepartie, par passion, « for the culture ». Les plateformes ne les rémunèrent pas, ou si peu, que leur parole devient un acte d’engagement en soi. Mais pour durer, il faudra, tôt ou tard, composer avec le système : accepter les partenariats, les collaborations, et les échanges de bons procédés.
Rien de nouveau : c’est un cycle. On l’a vu avec les premiers blogs des années 2000 : libres et insolents au début, absorbés ensuite. L’indépendance d’aujourd’hui pourrait redevenir vitrine demain. C’est un mouvement presque inévitable.

La critique n’a plus de trône ; elle a des visages. Ceux qui parlent ne représentent plus une institution, mais un point de vue. Hier, elle dictait ce qu’il fallait voir, porter, acheter. Aujourd’hui, elle dit ce que chacun ressent.
Aucun espace n’est totalement libre. Tout comme nous : tôt ou tard, on finit par devoir composer avec le système. Ce qui compte, c’est ce qu’on choisit d’en faire, et comment on continue à faire entendre nos voix.

